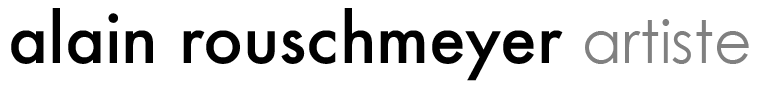Le marché de l’art vu depuis l’œil de l’artiste
Le marché de l’art est une scène mouvante, un théâtre où se croisent les œuvres, les egos, les chiffres et les intentions.
On en parle souvent en termes économiques, stratégiques ou sociologiques, mais rarement depuis le point de vue de l’artiste lui-même, celui qui crée, doute, expose, vend — ou pas. Celui qui reste à l’écart des projecteurs, le pinceau à la main, les yeux dans la lumière.
Dans ce texte, je propose un regard de l’intérieur, forcément subjectif, mais habité par l’expérience.
Pas une analyse exhaustive, ni une vérité figée, mais une traversée personnelle de ce vaste univers : celui de l’art, de sa diffusion, de sa réception, de ses paradoxes.
Un chemin parcouru chemin faisant, à la fois en peintre figuratif, en ancien architecte, en simple observateur d’un monde qui évolue vite.
Qu’est-ce qu’"avoir une place" aujourd’hui quand on est artiste ? Comment rester sincère sans se perdre dans les algorithmes ou les slogans ?
Entre émotion, parcours, commerce et authenticité, ce texte trace une cartographie intime du marché de l’art tel que je le perçois — depuis mon atelier, depuis mes toiles, depuis mes pas.
1 – L’art : un terme générique aux multiples tiroirs
Dire « l’art », c’est un peu comme ouvrir une armoire aux mille tiroirs, chacun contenant une histoire, un geste, une intention, un monde. Il y a l’art abstrait, l’art brut, l’art conceptuel, l’art naïf, le street art, le land art, le numérique, la performance… Et encore, ce ne sont là que des étiquettes, souvent posées a posteriori.
Chacun de ces styles a ses codes, ses références, ses lieux de diffusion. Certains s’exposent dans les grandes galeries, d’autres vivent dans la rue ou sur les réseaux. Ils ne parlent pas toujours la même langue — parfois, ils s’ignorent même.
Pour l’artiste, cette diversité est à la fois un terrain de liberté et un labyrinthe. Où se situer ? À quel moment son travail entre-t-il dans une case ? Faut-il d’ailleurs entrer dans une case pour exister dans ce marché aux repères mouvants ? Ce cloisonnement peut enfermer, mais il peut aussi protéger.
L’art, par essence, devrait être un espace de liberté et de décloisonnement. Et pourtant, dans un monde où tout se mesure, se classe, se monétise, même la création doit parfois cocher des cases. On attend de l’artiste qu’il s’inscrive dans une démarche identifiable, vendable, contextualisée.
Alors qu’au fond, créer, c’est peut-être précisément s’autoriser à ne pas entrer dans le moule.
Et puis, il y a cette autre question, plus sourde, mais bien réelle : l’art peut-il absorber les inégalités sociales, ou les reflète-t-il ?
Entre l’artiste à succès et celui qui peine à vendre une toile, entre les grandes foires internationales et les expositions locales, entre l’élite collectionneuse et le public des musées gratuits, le fossé est parfois vertigineux. L’art ne gomme pas les inégalités : il les traverse, les révèle, ou les subit.
Enfin, il y a les tendances — ces courants qui vont, viennent, s’imposent ou s’essoufflent. Le marché les adore. Elles donnent une direction, une justification, un emballage. Mais elles peuvent aussi éclipser les voix singulières, les artistes hors du temps, ceux qui avancent à contre-courant.
Là encore, il faut choisir : suivre le fil, ou le rompre. Et garder le cap de sa propre démarche, parfois fragile, mais sincère.
“La fille au lever du jour”
L'art est un mot aux contours flous, une couche infinie de significations et d'interprétations. Cette diversité m’évoque l’importance de ne pas se limiter à une seule définition ou catégorie, et dans mes toiles, je cherche à explorer ce mouvement continu entre abstraction et figuration.
2 – « L’art pour tous » : un générique énigmatique
On entend souvent cette formule : « l’art pour tous ». Elle sonne bien, elle semble généreuse, presque humaniste. Mais que cache-t-elle vraiment ? Et surtout, pour qui est-elle pensée ? Est-ce une réelle volonté d’ouverture ou un slogan creux, brandi pour cocher une case de bonne conscience culturelle ?
Quand on parle d’art pour tous, de quel « tous » s’agit-il ?
Celui qui fréquente les musées ? Celui qui achète en galerie ? Celui qui scroll sur Instagram ? Celui qui ne franchira jamais la porte d’un lieu d’exposition ? L’art est-il vraiment accessible quand il est codé, institutionnalisé, tarifé, parfois intimidant ?
La formule semble masquer une réalité plus complexe. Car l’accès à l’art ne se limite pas à la gratuité d’une entrée ou à la reproduction d’une œuvre dans un manuel scolaire. Il s’agit aussi d’un regard, d’un langage, d’une éducation du sensible. Et tout le monde n’a pas les mêmes clés, ni les mêmes repères.
L’artiste, lui, se trouve souvent pris dans cet entre-deux. Il crée pour exprimer, partager, toucher. Mais ses œuvres ne sont pas toujours reçues comme il l’espérait. Les filtres du marché, des institutions ou des algorithmes déforment parfois le lien direct avec le spectateur.
Et puis il y a ce paradoxe : plus on parle d’un art pour tous, moins on prend le temps d’un vrai dialogue entre les œuvres et les regards. On vulgarise, on simplifie, on rend « accessible » à tout prix, au risque d’aplatir la singularité.
Pour l’artiste, ce constat peut être frustrant. Il crée avec sincérité, dans un langage propre, souvent loin des tendances. Mais comment faire entendre cette voix dans un monde où les slogans priment parfois sur le contenu ? Où l’injonction à plaire à tous gomme la puissance de l’exception ?
L’art pour tous, oui… mais pas au prix de l’uniformisation.
L’enjeu n’est pas de produire un art « compatible » avec toutes les attentes, mais de faire confiance au regard de chacun, même si ce regard est dérangé, bousculé, déplacé. C’est là, peut-être, que l’art devient vraiment universel.
3 – L’univers virtuel du monde artistique
Depuis quelques années, le monde artistique a pris un virage numérique à grande vitesse. Il ne suffit plus d’exposer dans une galerie ou de participer à un salon : il faut aussi être visible en ligne, se rendre présent dans cet espace virtuel où l’art circule sous forme d’images compressées, éphémères, souvent scrollées sans pause.
Dans ce nouvel écosystème, les algorithmes dictent en grande partie ce qui est vu, aimé, partagé. Ils trient, sélectionnent, hiérarchisent selon des critères invisibles. L’artiste devient alors contenu parmi d’autres, et son œuvre, souvent pensée dans la durée, se retrouve prise dans un flot de publications où tout se ressemble, tout se remplace.
L’IA, cette fameuse prothèse cognitive, ajoute une autre couche de complexité. Elle fascine, elle interroge, elle dérange aussi. Certains y voient un outil d’expérimentation, d'autres une menace pour la singularité du geste humain. Peut-elle remplacer l’intuition, l’imperfection assumée, le doute créatif ?
Rien n’est moins sûr. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle bouleverse la place de l’artiste : non plus seul créateur, mais parfois simple curateur de données, d’images générées, recombinées, stylisées.
Et puis, il y a les réseaux sociaux — cet espace ambigu entre vitrine et piège. On y expose son travail, mais aussi soi-même. On y cherche la visibilité, parfois au prix d’une part de sincérité. Car ces plateformes, en apparence ouvertes, peuvent devenir des machines à aplatir, à standardiser, à transformer la diversité des expressions en un flux homogène et calibré.
Pour un artiste, ces outils sont à la fois des opportunités et des tensions. On peut y rencontrer un public inattendu, toucher des amateurs au-delà des cercles habituels. Mais on peut aussi s’y perdre, se diluer dans le rythme effréné de la publication, et oublier le temps long de la création.
L’univers virtuel offre de nouveaux territoires. Il mérite d’être exploré. Mais sans jamais oublier que l’art véritable ne se consomme pas comme une story. Il demande du silence, du regard, du recul. Et surtout, un espace où l’émotion ne soit pas compressée à 72 dpi.
4 – L’artiste et son parcours
Il n’y a pas de mode d’emploi pour devenir artiste. Pas de notice, pas de ligne droite. Certains passent par les grandes écoles, les concours, les formations diplômantes. D’autres avancent à tâtons, apprennent sur le tas, explorent sans filet. Mais tous expérimentent à leur manière ce parcours souvent chaotique.
L’école peut offrir un cadre, une stimulation, une confrontation aux regards. Mais elle ne garantit ni la reconnaissance, ni la persévérance. À l’inverse, l’autodidacte peut se sentir à l’écart des circuits officiels, mais il développe souvent une liberté plus radicale, un rapport plus instinctif à la création.
Et puis il y a ce moment charnière : le basculement entre "faire de l’art" et "être artiste". Ce n’est pas une simple question de statut ou de reconnaissance. C’est un engagement intérieur. Une façon de regarder le monde, de s’y inscrire, de lui répondre avec ses moyens : un pinceau, un crayon, un outil, un silence parfois.
On parle beaucoup aujourd’hui de “professionnalisation”, comme si l’artiste devait cocher des cases, suivre des tutoriels, optimiser sa visibilité, structurer son offre. Tout cela peut aider, bien sûr. Mais on oublie souvent que ce chemin reste profondément personnel, non-linéaire, fait de doutes, de retours, de bifurcations.
Il y a des hauts et des creux, des périodes fertiles et d’autres en jachère. Il y a l’enthousiasme des premières expositions, et le vertige du vide entre deux projets. Il y a les questions qui reviennent : “Est-ce que cela vaut le coup ? Est-ce que ça parle à quelqu’un ? Est-ce que je suis encore à ma place ?”
Mais il y a aussi ce fil invisible, tenace, qui relie l’artiste à son geste. Quelque chose de plus fort que la fatigue ou les doutes. Une nécessité intérieure. Un besoin de dire, de montrer, d’explorer, même si le monde ne regarde pas toujours.
Finalement, chaque parcours artistique est un chemin de crête, entre solitude et partage, entre liberté et contraintes. Ce qui compte, ce n’est pas la vitesse, ni le niveau d’exposition, mais la justesse du pas. Et cette capacité à rester fidèle à ce que l’on cherche, même si on ne le trouve pas tout de suite.
Dans mon travail artistique, la notion de chemin n’est pas qu’un motif ou un prétexte narratif. Elle est à la fois une méthode et une métaphore.
Je peins comme on marche : avec des détours, des haltes, des envies de traverser, de revenir, de regarder autrement.
Ma série « Chemin faisant » est née de cette idée : capter ce qui nous échappe souvent — les traces, les passages, les empreintes du quotidien, qu’il s’agisse d’un paysage, d’un fragment de rue, ou même… d’une paire de chaussures.
Chaque toile est un instant saisi sur le vif, une tentative de rendre sensible ce que nos regards pressés oublient.
C’est une marche intérieure autant qu’extérieure. Une façon de relier mes pratiques d’artiste, d’architecte et de carnettiste, dans une écriture plastique libre, sincère, figurative sans être figée, où le réel se mêle à l’imaginaire du pas.
“Chemin faisant”… j’avance. Et c’est peut-être là, entre deux pas, que la peinture trouve son souffle.
5 – L’émotion et l’authenticité
Il y a, au cœur de toute création artistique sincère, une matière première invisible : l’émotion.
Elle ne se mesure pas, ne s’explique pas toujours. Elle surgit, s’infiltre, s’impose parfois sans prévenir.
C’est elle qui donne sa densité au geste, sa vibration à la couleur, sa justesse à la forme.
Mais comment la préserver, cette émotion, dans un monde qui va vite, qui compare, qui classe, qui demande du contenu avant du silence ?
Comment rester authentique, quand les injonctions extérieures poussent à produire, à plaire, à se renouveler constamment ?
L’émotion, pour un artiste, est fragile. Elle ne se fabrique pas à volonté. Elle se cultive dans le temps, dans l’observation, dans la disponibilité intérieure. Il faut parfois s’éloigner, laisser décanter, attendre que l’image s’impose. Et cela va à l’encontre de la logique de rendement.
L’authenticité, elle, n’est pas un style. Ce n’est pas un effet, ni un mot creux. C’est une posture intérieure, presque éthique. Un engagement à ne pas trahir ce que l’on ressent, même si cela ne colle pas aux attentes du moment.
C’est oser montrer ce qui nous habite, sans fard, sans stratégie. Et ce n’est pas toujours confortable.
Il y a des jours où l’on doute, où ce qu’on fait semble trop simple, trop nu, trop en décalage. Mais c’est souvent dans ces moments-là que l’on touche à quelque chose de juste. Quelque chose qui résonne.
Car au fond, ce qui marque dans une œuvre, ce n’est pas sa perfection technique ou sa conformité aux modes.
C’est l’émotion qu’elle transporte, le trouble qu’elle suscite, ce qu’elle fait vibrer chez l’autre sans l’expliquer.
Et quand cette émotion traverse le regard de celui qui regarde, alors l’œuvre a trouvé sa place.
Elle est sortie de l’atelier pour devenir rencontre.
6 – La dimension commerciale
On parle souvent de la tension entre création et commerce, comme si l’un devait forcément trahir l’autre. Pourtant, dans le monde réel, un artiste vit aussi d’un équilibre : celui entre l’élan créatif et les nécessités matérielles.
Créer, c’est vital. Vendre, c’est vital aussi. Pas pour tout le monde peut-être, mais pour ceux qui ont fait de l’art une pratique à plein temps, cette question ne peut être écartée.
Il y a la cotation, par exemple. Un mot qui semble presque technique, voire neutre, mais qui est en réalité profondément social. Être coté, c’est être validé par un système. C’est entrer dans des grilles, des chiffres, des références. Cela rassure les acheteurs, les galeries, les investisseurs. Mais cela ne dit rien, ou si peu, de la valeur intime d’une œuvre.
Et surtout, cela peut mettre l’artiste en tension : produire ce qui se vend, ce qui est attendu, ce qui entre dans les cases. À quel prix ?
Il y a aussi l’aspect alimentaire du métier. Exposer, imprimer, encadrer, se déplacer… tout cela coûte. Et il faut bien que l’atelier tourne, que la peinture se renouvelle, que le temps passé à créer soit viable.
Certains jonglent avec plusieurs métiers, d’autres vivent de commandes, d’ateliers, d’illustrations. Mais tous, à un moment donné, se retrouvent confrontés à cette équation simple et brutale : comment continuer à créer sans s’épuiser à vendre ?
Et puis il y a le rapport au récit, à ce que l’on montre de soi. Car vendre une œuvre, aujourd’hui, c’est aussi raconter son histoire. Il faut savoir se présenter, parler de sa démarche, entrer dans le jeu du récit marchand, parfois à contrecœur.
Mais l’art, ce n’est pas qu’un produit. Et ce n’est pas un simple objet décoratif. C’est une présence, une trace, une intensité.
Ceux qui achètent vraiment une œuvre ne cherchent pas à "investir" : ils cherchent à être touchés, à établir un lien.
Et c’est peut-être là que l’équilibre se joue : ne jamais perdre de vue que la vente ne devrait pas être une compromission, mais une rencontre possible entre deux sensibilités.
Quant à l’histoire de l’art, elle regorge d’anecdotes sur ces artistes longtemps ignorés, puis soudain encensés. Cela rappelle une chose essentielle : le marché est fluctuant, mais l’œuvre, elle, demeure.
7 – L’art figuratif… le mien
Je fais de la peinture figurative. C’est une évidence pour certains, un anachronisme pour d’autres.
Dans un monde où l’abstraction conceptuelle domine parfois les galeries, où l’image est partout mais souvent sans corps, choisir de représenter, de suggérer, de rester en lien avec le visible, peut sembler presque subversif.
Mais pour moi, le figuratif n’est pas une nostalgie. C’est un langage.
Il ne s’agit pas de copier le réel, ni de l’illustrer servilement, mais de l’interpréter, d’en extraire la vibration, l’infime mouvement, le souffle.
Je cherche le moment où une posture, une lumière, un détail, deviennent porteurs d’émotion — presque malgré eux.
Je peins des corps, des paysages, des scènes traversées, mais c’est toujours l’entre-deux qui m’intéresse : entre le sujet et le regard, entre la scène et le hors-champ, entre la réalité et l’imaginaire.
Alors, est-ce que ça a encore du sens ? Je ne me pose pas la question en ces termes.
Le sens, c’est ce qui se révèle à celui qui regarde.
Moi, je trace mon chemin — chemin faisant — en tenant le fil de ce qui m’émeut, de ce que je veux transmettre, sans chercher à coller aux tendances.
Et puis il y a cette question que je garde souvent en tête :
le figuratif peut-il rester intemporel ?
Je crois que oui, si on le libère des clichés, si on lui rend sa fragilité, son inachèvement, sa sincérité.
Parce qu’au fond, ce que je peins, ce n’est pas une scène : c’est une présence.
Et tant qu’il y aura des regards pour s’y attarder, des silences pour l’accueillir, le figuratif aura toute sa place. Non pas comme une mode, mais comme une manière sensible d’habiter le monde.
Ce lien avec le monde, je le dois aussi à mon parcours d’architecte. L’architecture m’a appris à observer autrement — à capter les volumes, les rythmes, les pleins et les vides. Elle m’a donné le goût de la structure, du dessin pensé comme un espace à traverser, et non comme une simple surface à couvrir.
Dans ma peinture, il y a toujours quelque chose de cette grille invisible, de cette tension entre l’intime et le construit. Un fragment de ville, un cadre de fenêtre, une ombre portée, une silhouette en mouvement : autant de signes qui viennent ancrer le regard dans un espace réel, mais chargé d’émotion.
Mon art figuratif est nourri de cette double culture du trait et du lieu, du sensible et du bâti. Une architecture qui se ferait peau, lumière, ou silence.
Et c’est peut-être là que tout se rejoint :
donner forme à ce qui nous traverse, dans des cadres mouvants, habités, ouverts sur le monde.
Artiste cherche boussole…
Le marché de l’art n’est ni un terrain de jeu ni une science exacte. Il est un reflet des tensions entre la création et le besoin de reconnaissance, entre l’authenticité et les enjeux commerciaux. Mais, pour l’artiste, ce chemin reste avant tout une quête personnelle, celle de donner forme à son univers, de rester fidèle à son geste, à ses émotions, même lorsque les lumières du marché s’imposent.
À travers ces lignes, j’ai voulu partager ma vision, humble mais sincère, d’un marché où l’artiste doit savoir naviguer sans se perdre. L’art, après tout, n’est pas un produit de consommation, mais un acte de présence. Une œuvre, qu’elle soit figée dans un cadre ou mise en circulation, a la capacité de résonner avec ceux qui la croisent, de dépasser les étiquettes et de transcender les modes.
Mon art, à la croisée de l’architecture et de la peinture figurative, reste une invitation à voir autrement, à ressentir plus intensément. Si le marché de l’art évolue, les émotions qu’il suscite, elles, demeurent intemporelles.